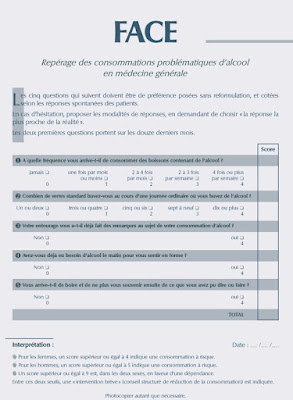Bonjour à tous! Il y a eu de nombreux articles à lire, mais j'ai réussi à ne pas être en retard cette semaine! J'en ai sélectionnés quelques uns qui me paraissaient intéressant, comme d'habitude. Malheureusement, il y en a beaucoup trop pour que ma chronique soit exhaustive (Et de toutes façon ça me prendrait trop de temps!)
Bonne lecture!
1/ Médecine générale
La multimordibité est un sujet vaste et passionnant concernant de nombreux patients en médecine générale. Une étude allemande a étudié les désaccords entre les patients atteints de polypathologie et leur médecin généraliste. Les manques de communication entre les intervenants de la coordination de soin, la gestion des pathologies par le médecin généraliste, la communication entre le médecin et le patient et les différences de compréhension entre le médecin et le patient sur les maladies. Ainsi, on s’aperçoit que la prise en charge des patients multimorbides en médecine générale nécessite une communication importante entre les intervenants et le patient.
2/ Cardio-vasculaire
Commençons par une nouvelle bien venue: le déremboursement de l'Olmesartan (Alteis etc..). Son Service Médical Rendu a été réévalué en "insuffisant", son utilisation pouvant engager le pronostic vital. Bref, une bonne nouvelle étant donné que l'utilisation d'un IEC est mieux et qu'en cas d’intolérance, le valsartan est un meilleur choix comme j'en avais déjà parlé ici.
Les américains recommande un dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale à partir de 65ans chez l'homme. Un modèle a été recherché pour prédire le risque d'anévrisme de l'aorte dans cette étude. J'aime bien les modèles prédictifs et ce genre de chose, mais en l’occurrence, cette étude dosait chez les patients TOUT ce qu'il était possible de doser ayant plus ou moins un lien avec le coeur: leucocytes, fibrinogène CRP, troponine, NT pro-BNP, et D-dimères. Ils ont retrouvé que la présence d'une élévation de ces marqueurs augmente le risque d'anévrisme par rapport à ceux en ayant aucun. C'est probablement plus intelligent de se cantonner aux recommandations que de doser tout ça pour trouver un certain nombre de marqueurs positifs dont on ne saura absolument quoi faire chez un patient asymptomatique. Quoi qu'une élévation de la troponine , on pourra toujours envoyer le patient aux urgences... ("Et pourquoi votre médecin a fait le dosage? - Pour regarder mon ventre docteur!")
Cet article étudie l'amélioration de l'albuminurie chez les patients hypertendus non diabétiques traitées par bloqueurs du système rénine angiotensine. L'utilisation de l'Eplérénone en plus permet une amélioration du ration albuminurie/créatininurie sans majoration de hyperkaliémies sévères. La comparaison au placebo n'est pas justifiée car l'ajout d'un diurétique thiazidique a déjà démontré une efficacité supérieure au placebo. L'Eplerenone n'est clairement pas le premier diurétique que j'aurai envie d'utiliser dans l'hypertension avec néphropathie.
Enfin, la stat-ala-khon de la semaine concerne le chocolat, encore une fois! Cette fois il ne fait pas perdre du poids, il diminue le risque d'évènement cardio-vasculaire!!! Les études portant sur les habitudes alimentaires avec des critères de jugement comme ça, les facteurs de confusion sont multiples, le recueil de la consommation de chocolat particulièrement difficile: le recueil a été fait par questionnaire entre 1993 et 1997 pour une date de point en 2008. La consommation a probablement variée durant ces 10 ans...
3/ Infectiologie
Pour commencer cette partie, parlons des infections urinaires associées aux soins ( IUAS). C'est pas de la médecine générale, mais ça pourra servir aux médecins hospitaliers qui me lisent. Ces recommandations de la spilf statuent sur le fait qu'une IUAS doit être évoquée chez les patients uniquement en cas de symptômes, qu'en absence de sonde urinaire, les critères sont ceux des infections urinaires habituelles, et qu'en présence de sonde urinaire, il ne faut pas tenir compte de la leucocyturie mais uniquement d'une bactériurie supérieure à 100 000 ufc/ml. La notion d'IUAS peut être retenue si l'infection survient dans les 48 heures suivant une chirurgie urinaire ou dans les 7 jours suivant le retrait d'un dispositif de drainage urinaire. La suite du document permet de savoir qui traiter précisément, notamment en prévention, et avec quels antibiotiques.
Ensuite, je suis tombé sur les recommandations vaccinales de "cocooning" prévention de la coqueluche chez le nourrisson aux Etats Unis. Et bien c'est comme chez nous, sauf qu'ils proposent une vaccination au 3ème trimestre de grossesse pour être sur que ce soit fait!
Enfin, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus fait encore parler d'elle. Alors que les vaccins bi et quadrivalents ont montré leur efficacité en 2 injections, le vaccin bivalent serait aussi efficace en une seule injection, les multiples injections assurant une meilleure protection croisée contre les souches virales non présentes dans le vaccin. Dans cette étude, le suivi est court: 4 ans et le place des labo importante, de quoi relativiser fortement les résultats (même si c'est pas dans leur intérêt de ne vendre qu'un vaccin au lieu de 3, peut être vendront il plus de 1 vaccin qu'ils ne vendent actuellement compte tenu des réticences des patients aux multiples injections). Dans les truc pas trop logiques, plus on a de dose, plus l'efficacité du vaccin est faible (85% pour 1 dose, 76% pour 2 doses et 77% pour 3 doses. On regrette quand même qu'aucune comparaison entre les groupes ne soit faite (à moins que ça ait été fait et le résultat n'étant pas celui attendu, ça n'apparaisse finalement pas...)
4/ Diabétologie
Je commence par une petite piqure de rappelle sur la metformine et l'insuffisance rénale. L'article enfonce un peu des portes ouvertes: la metformine quand la créatinine est supérieure à 530µmol/L, ça multiplie par 1,35 le risque de mortalité en moyenne et ce, de façon proportionnelle à la dose de metformine. Étonnamment, ce n'était pas lié à des acidoses métaboliques qui n'étaient pas différentes dans les 2 groupes. Il y a donc un risque propre à la metformine en cas d'insuffisance rénale, sans que l'acidose lactique ne soit la pathologie à redouter. Au passage, 530µmol/L de créat', ça fait quand même moins de 15ml/min d'estimation du DFG... alors on est pas dans la comparaison entre utilisation ou pas de metformine chez un patients diabétique avec une fonction rénale entre 30 et 45mL/min, ce qui serait plus intéressant en pratique quotidienne.
Pour finir, un progrès: pancréas artificiel avec insuline + glucagon versus pancréas artificiel avec insuline versus pompe à insuline, chez les diabétiques de type 1 en essai contrôle randomisé. Ca vends du rêve, mais avec 6 schémas différents à randomiser en 6 groupes, les 33 patients inclus et le suivi de 3 nuits consécutives seulement, rendent cette étude de très faible niveau de preuve. Bref, les comparaisons multiples ont été prises en compte et l'analyse de l'étude portant sur la tolérance nocturne. L'utilisation du pancréas avec double hormones a permis d'éviter les hypoglycémies (glycémie inférieure à 4mmol/L) significativement par rapport aux autres groupes (avec moins d’hypoglycémies clinique également; même si faire des statistiques avec 0 patients ayant eu l'évènement dans un groupe, on aime vraiment pas..) Tout ça pour dire que le pancréas avec insuline et glucagon doit être étudié dans des études de plus grandes échelle pour essayer de prouver que c'est un traitement efficace du diabète de type 1.
Je vous remercie de m'avoir lu, et à la semaine prochaine!!
@Dr_Agibus